Marie de Nazareth


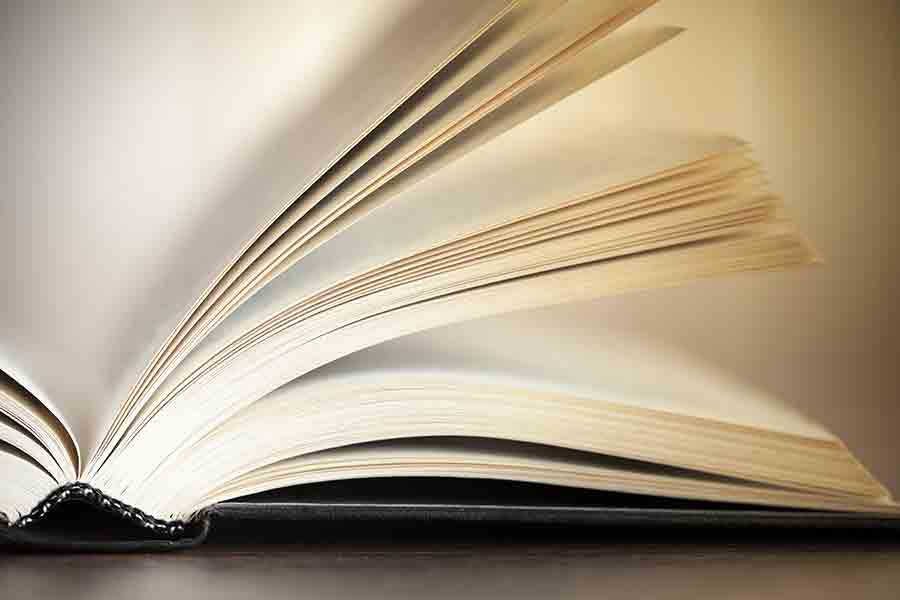
168.1 Marie travaille paisiblement sur une toile. C’est le soir. Toutes les portes sont fermées, une lampe à trois becs éclaire la petite pièce de Nazareth et plus particulièrement la table auprès de laquelle la Vierge est assise. La toile – c’est peut-être un drap – retombe du coffre et de ses genoux jusqu’à terre et Marie, vêtue de bleu foncé, paraît émerger d’un tas de neige. Elle est seule. Elle coud avec agilité, la tête penchée sur son ouvrage, et la lumière éclaire le haut de sa tête en y produisant des reflets d’or pâle. Le reste du visage est dans la pénombre.
Dans la pièce bien rangée règne le plus grand silence. Il ne vient même aucun bruit de la rue, déserte pendant la nuit, et pas plus du jardin. La lourde porte qui, de la pièce où Marie travaille – celle où elle a l’habitude de prendre ses repas et de recevoir ses amis –, conduit au jardin, est fermée et fait même obstacle au bruit de la fontaine qui jaillit dans le bassin. Je voudrais bien savoir à quoi peut penser la Vierge pendant que ses mains s’activent sur sa couture…
On frappe discrètement à la porte qui donne sur la rue. Marie lève la tête, écoute… Le coup a été si léger que Marie doit penser qu’il est le fait de quelque animal nocturne ou d’un peu de vent qui a secoué la porte, et elle penche de nouveau la tête sur son travail. Mais on frappe plus distinctement. Marie se lève et se dirige vers la porte. Avant d’ouvrir, elle demande :
« Qui frappe ? »
Une voix faible répond :
« Une femme. Au nom de Jésus, ouvre-moi. »
Marie ouvre aussitôt, en tenant haut la lampe pour distinguer qui est cette pèlerine. Elle voit un amas d’étoffe, un enchevêtrement dont rien ne transparaît, un pauvre enchevêtrement qui s’incline profondément en disant :
« Salut, Maîtresse. »
Et elle répète :
« Au nom de Jésus, aie pitié de moi.
– Entre et dis-moi ce que tu veux. Je ne te connais pas.
– Personne ne me connaît et beaucoup me connaissent, Maîtresse. Le vice me connaît. La sainteté elle aussi me connaît. Mais j’ai besoin que la miséricorde m’ouvre les bras. Or la miséricorde, c’est toi… »
Elle pleure.
« Mais entre donc… et dis-moi… Tu en as assez dit pour que je comprenne que tu es malheureuse… Mais qui tu es, je ne le sais toujours pas. Quel est ton nom, ma sœur ?
– Ah non ! Pas “ ma sœur ” ! Je ne puis être ta sœur… Tu es la Mère du Bien… moi… moi je suis le mal… »
Elle redouble de larmes sous son manteau qui la cache entièrement.
Marie pose la lampe sur un siège, prend la main de l’inconnue agenouillée sur le seuil, et l’oblige à se lever.
168.2 Marie ne la connaît pas… moi, si : c’est la femme voilée de la Belle Eau.
Elle se lève, humble, tremblante, secouée de sanglots, mais hésite encore à entrer :
« Je suis païenne, Maîtresse. Pour vous, les juifs, autant dire une ordure, même si j’étais sainte. Mais une ordure à double titre, parce que je suis une prostituée.
– Si tu viens à moi, si tu cherches mon Fils à travers moi, tu ne peux plus être qu’un cœur qui se repent. Cette maison accueille tout ce qui s’appelle douleur. »
Et elle l’attire à l’intérieur, referme la porte, remet la lampe sur la table et lui offre un siège en disant :
« Parle. »
Mais la femme voilée ne veut pas s’asseoir ; légèrement inclinée, elle continue à pleurer. Marie, douce et majestueuse, se tient devant elle. Elle attend, en priant, que son chagrin s’apaise. Je la vois qui prie à toute son attitude, bien que rien en elle ne révèle qu’elle prie. Ni ses mains, qui tiennent toujours la petite main de la femme voilée, ni ses lèvres closes.
Enfin, les pleurs se calment. La femme voilée s’essuie le visage de son voile, puis dit :
« Mais je ne suis pas venue de si loin pour rester inconnue. C’est l’heure de ma rédemption et je dois me révéler pour… pour te montrer de combien de plaies mon cœur est couvert… Or… tu es une mère… sa Mère… par conséquent tu auras pitié de moi.
– Oui, ma fille.
– Oh, oui ! Appelle-moi “ ma fille ” ! J’avais une mère… mais je l’ai abandonnée… On m’a appris par la suite qu’elle en était morte de chagrin… J’avais un père… il m’a maudite, et il disait aux gens de la ville : “ Je n’ai plus de fille. ” »
Une violente crise de larmes la saisit. Marie est peinée jusqu’à en pâlir. Mais elle lui pose une main sur la tête pour la réconforter. La femme voilée reprend :
« Je n’aurai plus personne qui m’appelle “ ma fille ” ! Oui, comme ça, caresse-moi comme ça, comme ma mère le faisait… quand j’étais pure et bonne… Laisse-moi t’embrasser la main et m’en servir pour essuyer mes larmes. Elles seules ne me lavent pas. Comme j’ai pleuré depuis que j’ai compris ! Certes, j’avais aussi pleuré auparavant, car c’est horrible de n’être qu’une chair vendue, insultée par l’homme. Mais ce n’étaient que les plaintes d’un animal brutalisé qui hait et se révolte contre celui qui le torture et le souille toujours plus… je changeais de maître, mais c’était toujours la même bestialité… Cela fait huit mois que je pleure… parce que j’ai compris… J’ai compris ma misère, ma pourriture. J’en suis couverte et cela me donne la nausée… Mais mes larmes ont beau être toujours plus conscientes, elles ne me lavent pas. Elles se mêlent à ma pourriture, mais ne l’enlèvent pas. Oh ! Mère, essuie-moi de ces larmes, et je serai purifiée, je pourrai m’approcher de mon Sauveur !
– Oui, ma fille, oui. Assieds-toi là, avec moi, et parle en paix. Dépose tout ton fardeau ici, sur mes genoux de Mère. »
Marie s’assied.
168.3 Mais la femme voilée glisse à ses pieds et veut parler dans cette position. Elle commence doucement :
« Je suis de Syracuse… J’ai vingt-six ans… J’étais la fille d’un intendant, comme vous dites, ou – dans notre vocabulaire – du procurateur d’un grand seigneur romain. J’étais fille unique. Je vivais heureuse. Nous habitions près de la plage dans la magnifique villa dont mon père était l’intendant. De temps à autre, le maître de maison venait, ou bien sa femme, ses enfants… Ils nous traitaient bien et se montraient gentils avec moi. Les petites filles jouaient avec moi… Ma mère était heureuse… Elle était fière de moi. J’étais belle… j’étais intelligente… tout me réussissait facilement… Mais je préférais les choses frivoles aux bonnes. A Syracuse, il y a un grand théâtre. Un grand théâtre, beau, vaste… Il sert aux jeux et à la comédie. Dans les comédies et les tragédies qu’on y donne, on se sert beaucoup de mimes. Ils soulignent par leurs danses muettes la signification du chœur. Tu ne sais pas… mais les mains, les mouvements du corps peuvent exprimer les sentiments de l’homme agité par quelque passion… Dans un gymnase spécial, on enseignait à des adolescents et à des jeunes filles le métier de mime. Ils doivent être beaux comme des dieux et agiles comme des papillons… J’aimais beaucoup monter sur une espèce de hauteur qui dominait cet endroit et regarder les danses des mimes. Je les reproduisais ensuite sur les prés fleuris, sur le sable blond de ma terre, dans le jardin de la villa. Je ressemblais à une statue artistique, ou bien à un vent qui survole, tant je savais me fixer dans des poses de statue ou voler en touchant à peine le sol. Mes riches amies m’admiraient… et maman en était fière… »
La femme voilée parle, se souvient, revoit le passé et pleure. Ses paroles sont ponctuées de sanglots.
« Un jour – c’était au mois de mai –, Syracuse était toute en fleurs. Les fêtes étaient terminées depuis peu et, moi, j’avais été enthousiasmée par une danse exécutée au théâtre… Ce sont les maîtres qui m’y avaient emmenée, avec leurs filles. J’avais quatorze ans… Dans cette danse, les mimes devaient représenter les nymphes du printemps accourant pour adorer Cérès ; elles dansaient couronnées de roses, revêtues de roses… seulement de roses, car leur vêtement était un voile des plus légers, un filet de fil d’araignée sur lequel les roses étaient éparses… La légèreté avec laquelle elles dansaient était telle qu’elles ressemblaient à des Hébé ailées. Leur corps splendide transparaissait à travers les écharpes de voile fleuri qui, dénouées, formaient des ailes derrière elles. J’ai étudié la danse… et un jour… un jour… »
168.4 La femme voilée pleure encore plus fort, puis elle se reprend.
« J’étais belle. Je le suis encore. Regarde. »
Elle se dresse debout, rejette rapidement son voile en arrière et laisse retomber son manteau. Je suis ébahie, parce que je vois surgir, des étoffes qu’elle a repoussées, Aglaé, très belle dans son vêtement modeste, coiffée très simplement avec des tresses, sans bijoux, sans étoffes de prix, une vraie fleur de chair, svelte et pourtant parfaite, avec un très beau visage brun clair et des yeux veloutés mais pleins de feu.
Elle revient s’agenouiller devant Marie :
« Pour mon malheur, j’étais belle, et j’étais folle. Ce jour-là, je me revêtis de voiles. Les filles de mon maître, qui aimaient me voir danser, m’y aidèrent. Je m’habillai dans un coin de la plage blonde, face à la mer bleue. Sur la plage, déserte à cet endroit, il y avait des fleurs sauvages blanches et jaunes au parfum pénétrant d’amandier, de vanille, de chair à peine pure. Des agrumes émanaient des bouffées de senteurs capiteuses, les roses de Syracuse embaumaient, de même que la mer et le sable ; le soleil faisait exhaler des odeurs de toutes choses… Un vague sentiment de panique me montait à la tête. Je me sentais nymphe, moi aussi, et j’adorais… quoi ? La terre fertile ? Le soleil qui la féconde ? Je ne sais. Païenne parmi les païens, je crois que j’adorais la Sensualité, cette reine despotique, que je ne pensais pas avoir en moi, mais qui était plus puissante qu’un dieu… Je me suis couronnée de roses que j’avais prises dans le jardin, et j’ai dansé, dansé… J’étais ivre de lumière, de parfums, ivre du plaisir d’être jeune, agile et belle. Je dansais… et on m’a vue. J’ai remarqué qu’on me regardait. Mais je n’ai pas eu honte de me montrer nue aux yeux avides d’un homme. Au contraire, je me complaisais à parfaire mes sauts… Le plaisir d’être admirée me donnait vraiment des ailes… Et ce fut ma ruine. Trois jours plus tard, je demeurai seule parce que les maîtres de maison avaient regagné leur demeure patricienne de Rome. Mais je ne suis pas restée à la maison… Ces deux yeux admirateurs m’avaient révélé autre chose que la danse… Ils m’avaient révélé la sensualité et le sexe. »
Marie a un geste de dégoût involontaire qu’Aglaé remarque.
« Oh, mais tu es pure, et je dois te paraître répugnante.
– Parle, parle, ma fille. Il vaut mieux que ce soit à Marie qu’à lui. Marie, c’est la mer qui lave.
– Oui, il vaut mieux que ce soit à toi, c’est aussi ce que je me suis dit quand j’ai su qu’il avait une Mère… Car, au premier abord, en le voyant si différent de tout autre homme, le seul à être tout esprit – maintenant je sais que l’esprit existe et ce que c’est –, je n’aurais su dire de quoi était fait ton Fils pour être ainsi pur de toute sensualité bien qu'étant un homme, et je m’imaginais qu’il n’avait pas de mère, mais qu’il était descendu comme cela sur terre, pour sauver les horribles misères dont je suis la plus grande…
168.5 Je revenais chaque jour à cet endroit dans l’espoir de revoir cet homme jeune, brun, beau… De fait, après quelque temps, je le revis. Il me parla. Il me dit : “ Viens à Rome avec moi. Je t’amènerai à la cour impériale, tu seras la perle de Rome. ” Je répondis : “ Oui, je serai ta fidèle épouse. Viens chez mon père. ” Il se mit à rire d’un air moqueur et me donna un baiser. Il précisa : “ Pas mon épouse, mais ma déesse. Je serai ton prêtre, et je te révélerai les secrets de la vie et du plaisir. ” J’étais folle, j’étais jeune. Malgré tout, je n’ignorais pas les réalités de la vie… J’étais rusée. J’étais folle, mais pas encore dépravée… et sa proposition m’a dégoûtée. Je m’échappai de ses bras et courus à la maison. Mais je n’ai rien dit à ma mère… et je n’ai pas su résister à la tentation de le revoir. Ses baisers m’avaient rendue encore plus folle… et j’y suis retournée. J’étais à peine revenue sur cette plage solitaire que déjà il m’embrassait, me donnant des baisers avec frénésie, une vraie pluie de baisers, de mots d’amour, de questions : “ Est-ce que tout n’est pas dans cet amour ? N’est-ce pas plus doux que les liens du mariage ? Que veux-tu d’autre ? Peux-tu vivre sans cela ? ”
Oh, Mère ! Le soir même, je me suis enfuie avec ce patricien dégoûtant… Et je fus une vraie loque piétinée par sa bestialité… Pas une déesse, mais de la boue. Pas une perle, mais du fumier. Ce n’est pas la vie qu’il m’a révélée, mais l’ordure de la vie, l’infamie, le dégoût, la souffrance, la honte, l’infinie misère de ne même plus m’appartenir. Et puis… ce fut la chute complète. Après six mois d’orgie, fatigué de moi, il est passé à de nouvelles amours et je me suis retrouvée à la rue. J’utilisai alors mes talents de danseuse… Je savais désormais que ma mère était morte de chagrin et que je n’avais plus de maison, plus de père… Un maître de danse m’accueillit dans son gymnase. Il me fit faire des progrès… m’exploita… et me lança comme une fleur au courant de tous les arts sensuels au milieu du patriciat corrompu de Rome. Déjà souillée, la fleur tomba dans un égout. Ce furent dix années de descente à l’abîme, toujours plus bas. Puis on m’amena ici pour charmer les loisirs d’Hérode, et je fus prise par un nouveau maître. Ah ! Il n’est pas de chien enchaîné qui le soit plus que nous ! Et il n’y a pas de dresseur de chiens qui soit plus brutal que l’homme qui possède une femme ! Mère… tu trembles ! Je te fais horreur ! »
Marie a porté la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup. Mais elle répond :
« Non, pas toi. Ce qui me fait horreur, c’est le Mal qui domine tellement la terre. Continue, ma pauvre enfant.
– Il m’a amenée à Hébron… Est-ce que j’étais libre ? Est-ce que j’étais riche ? Oui, puisque je n’étais pas en prison et que j’étais couverte de bijoux. Non, car je ne pouvais voir que ceux qu’il voulait, lui, et je n’avais plus aucun droit sur moi-même.
168.6 Un jour, un homme vint à Hébron : l’Homme, ton Fils. Cette maison lui était chère. Je le savais et je l’invitai à entrer. Shammaï n’était pas là… par la fenêtre, j’avais déjà entendu ses paroles et vu une personne qui m’avait bouleversée. Mais je te le jure, Mère, ce n’est pas la chair qui m’a poussée vers ton Jésus. C’est ce qu’il m’a révélé qui m’a guidée sur le seuil de la porte, au mépris des plaisanteries des gens, pour lui dire : “ Entre. ” Ce fut mon âme, dont j’appris alors l’existence. Il me dit : “ Mon nom signifie Sauveur. Je sauve ceux qui ont un réel désir d’être sauvés. Je sauve en enseignant à être pur, à vouloir rechercher l’honneur, le bien à tout prix, quitte à en souffrir. Je suis celui qui vient chercher ceux qui étaient perdus, celui qui donne la vie. Je suis Pureté et Vérité. ” Il m’a encore appris que je possédais moi aussi une âme et que je l’avais tuée par ma manière de vivre. Mais il ne m’a pas maudite, il ne s’est pas moqué de moi. Pas une fois il ne m’a regardée ! C’est le premier homme à ne pas m’avoir dévisagée d’un regard avide, car j’ai la terrible malédiction d’attirer les hommes… Il m’a dit que qui le cherche le trouve, parce qu’il se trouve là où on a besoin d’un médecin et de remèdes. Puis il est parti. Mais ses paroles sont restées en moi, et elles n’en sont plus sorties. Je me disais : “ Son nom signifie Sauveur ”, comme pour commencer à guérir. Ses paroles m’étaient restées, ainsi que ses amis les bergers. Et je fis mon premier pas pour leur apporter mon obole et demander leur prière… Après quoi… je me suis enfuie…
Ah, quelle sainte fugue ! J’ai fui le péché, à la recherche du Sauveur. Je suis allée le chercher, certaine de le trouver puisqu’il me l’avait promis. On m’a envoyée auprès d’un homme du nom de Jean en me disant que c’était lui. Mais ce n’était pas lui. Un juif me dirigea vers la Belle Eau. Je vivais grâce à la vente de l’or que j’avais en grande quantité. Pendant les mois où j’étais à sa recherche, j’avais dû me couvrir le visage pour ne pas risquer d’être reprise et parce que, réellement, Aglaé était ensevelie sous ce voile. L’ancienne Aglaé était morte. Il y avait sous ce voile son âme blessée et exsangue qui cherchait son médecin. Il m’a fallu bien des fois échapper à la sensualité des hommes qui me poursuivaient, bien que je sois camouflée sous ce vêtement. Même un des amis de ton Fils…
168.7 Je vivais à la Belle Eau comme une bête, pauvre mais heureuse. Les averses et le fleuve m’ont moins purifiée que ses paroles. Ah, je n’en ai perdu aucune ! Une fois, il a pardonné à un assassin. J’avais entendu, et j’ai failli lui dire : “ Pardonne-moi, à moi aussi. ” Une autre fois, il a parlé de l’innocence perdue… Ah ! Quels pleurs de remords ! Ou encore il a guéri un lépreux… et je fus sur le point de crier : “ Purifie-moi de mon péché… ” Il a aussi guéri un fou, or c’était un Romain… j’ai pleuré… et il me fit dire que les patries passent, mais que le Ciel reste. Un soir de tempête, il m’accueillit dans la maison… puis il me fit trouver un logement par le régisseur… et il me fit dire par l’entremise d’un enfant : “ Ne pleure pas ”… Oh ! sa bonté ! oh ! ma misère ! Elles étaient toutes deux si grandes que je n’osais pas porter ma misère à ses pieds… bien que l’un de ses disciples m’ait instruite, une nuit, sur l’infinie miséricorde de ton Fils. Par la suite, il fut exposé aux pièges de ceux qui voyaient un péché dans le désir qu’avait une âme de renaître. Mon sauveur est parti… et moi, je l’ai attendu… de même que m’attendait la vengeance de gens plus indignes que moi de le regarder. Car, moi, c’est en tant que païenne que j’ai péché contre moi-même, alors qu’eux ont péché contre le Fils de Dieu, bien que connaissant Dieu. Ils m’ont frappée, et leur accusation m’a blessée plus que les pierres, mon âme poussée au désespoir a été blessée plus que mon corps.
Ah ! Quelle terrible lutte contre moi-même ! Déchirée, en sang, blessée, fiévreuse, privée de mon Médecin, sans toit ni pain, j’ai regardé en arrière, devant moi… Le passé me conseillait : “ Reviens ”, le présent me soufflait : “ Tue-toi ”, le futur m’exhortait : “ Espère. ” J’ai espéré. Je ne me suis pas suicidée. Je le ferais si, lui, il me chassait, car je ne veux plus être celle que j’étais. Je me suis traînée jusqu’à un village pour y demander un abri. Mais j’y ai été reconnue. Comme une bête, j’ai dû fuir çà et là, toujours poursuivie, toujours méprisée, toujours maudite parce que je voulais être honnête et que j’avais déçu ceux qui voulaient frapper ton Fils par mon intermédiaire. J’ai suivi le fleuve pour remonter jusqu’en Galilée, et je suis venue ici. Mais tu étais absente… Je suis alors allée à Capharnaüm. Mais tu venais d’en partir. Un vieillard m’a vue, un de ses ennemis, et il m’a fait un texte d’accusation contre lui, ton Fils. Et comme je pleurais sans réagir, il m’a dit… il m’a dit… : “ Tout pourrait changer pour toi si tu acceptais d’être ma maîtresse et ma complice pour accuser le Rabbi de Nazareth. Il suffit que tu dises devant mes amis qu’il était ton amant… ” Je me suis enfuie comme si j’avais vu grouiller un nœud de vipères sous un buissons de fleurs.
168.8 J’ai compris de cette façon que je ne pouvais aller à ses pieds… si bien que je viens aux tiens. Piétine-moi donc, je ne suis que de la boue. Chasse-moi, je suis la pécheresse. Donne-moi mon nom : prostituée. J’accepterai tout de toi, mais aie pitié de moi, Mère. Prends ma pauvre âme souillée et porte-la lui. C’est un péché que de remettre entre tes mains ma luxure. Mais il n’y a que là qu’elle sera protégée du monde, qui la réclame, et qu’elle deviendra pénitence. Dis-moi comment faire. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi quels moyens je dois mettre en œuvre pour n’être plus Aglaé. Que dois-je mutiler en moi ? Qu’est-ce que je dois m’arracher pour n’être plus péché, plus séduction, pour ne plus rien avoir à craindre de moi-même et de l’homme ? Dois-je m’arracher les yeux ? Dois-je me brûler les lèvres ? Dois-je me couper la langue ? Mes yeux, mes lèvres, ma langue m’ont servi à faire le mal. Je ne veux plus du mal et je suis disposée à me punir et à les punir en les sacrifiant. Ou bien veux-tu que je m’arrache ces reins avides qui m’ont poussée à des amours dépravées ? Ces entrailles insatiables dont je crains toujours le réveil ? Dis-moi, dis-moi comment on s’y prend pour oublier qu’on est femme et pour faire oublier qu’on est femme ! »
Marie est bouleversée. Elle pleure, elle souffre, mais les seuls signes de sa douleur, ce sont les larmes qui tombent sur la repentie.
« Je veux mourir pardonnée. Je veux mourir sans autre souvenir que mon Sauveur. Je veux mourir avec sa sagesse pour amie… et je ne peux plus l’approcher car le monde nous guette, lui et moi, pour nous accuser… »
Tombée à terre comme une vraie loque, Aglaé pleure.
168.9 Presque haletante, Marie se lève en murmurant :
« Comme il est difficile d’être rédempteurs ! »
Aglaé, qui entend ce murmure et voit sa réaction, gémit :
« Tu vois ? Tu vois qu’à toi aussi j’inspire le dégoût ? Maintenant, je m’en vais. C’en est fini pour moi !
– Non, ma fille. Non, ce n’est pas fini. Pour toi maintenant, tout commence. Ecoute, pauvre âme. Ce n’est pas pour toi que je gémis, mais pour le monde cruel. Non seulement je ne te laisse pas partir, mais je te recueille, pauvre hirondelle que la bourrasque a abattue contre mes murs. Je t’amènerai à Jésus et, lui, il t’indiquera le chemin de la rédemption…
– Je n’ai plus d’espoir… Le monde a raison. Je ne peux être pardonnée.
– Par le monde, non. Mais par Dieu, oui. Laisse-moi te parler au nom du suprême Amour qui m’a donné un Fils pour que je le donne au monde. Il m’a sortie de la bienheureuse ignorance de ma virginité consacrée pour que le monde obtienne le pardon. Il a pris mon sang non de l’enfantement, mais de mon cœur en me révélant que mon Fils est la grande victime. Regarde-moi, ma fille. Il y a dans ce cœur une grande blessure. Elle gémit depuis trente ans et plus. Elle ne cesse de s’élargir et me consume. Sais-tu quel nom, elle a ?
– Douleur ?
– Non. Amour. Et c’est cet amour qui me saigne pour que le Fils ne soit pas seul à opérer le salut. C’est l’amour qui met en moi un feu pour que je purifie ceux qui n’osent pas aller vers mon Fils. C’est l’amour qui suscite en moi les larmes par lesquelles je lave les pécheurs. Tu voulais mes caresses. Je te donne mes larmes qui déjà te purifient pour que tu puisses regarder mon Seigneur. Ne pleure pas ainsi. Tu n’es pas la seule pécheresse qui vient au Seigneur et repart rachetée. Il y en a eu d’autres, et il y en aura d’autres.
Doutes-tu qu’il puisse te pardonner ? Mais ne vois-tu pas en tout ce qui t’est arrivé une mystérieuse volonté de la bonté divine ? Qui t’a amenée en Judée ? Qui t’a conduite dans la maison de Jean ? Qui t’a mise à la fenêtre ce matin-là ? Qui a allumé une lumière pour toi pour éclairer ses paroles ? Qui t’a donné la capacité de comprendre que la charité, unie à la prière de celui qui reçoit un bienfait, obtient l’aide de Dieu ? Qui t’a donné la force de t’enfuir de la maison de Shammaï et de persévérer les premiers jours jusqu’à l’arrivée de mon Fils ? Qui t’a mise sur son chemin ? Qui t’a rendue capable de vivre en pénitente pour purifier toujours plus ton âme ? Qui t’a rendu l’âme d’une martyre, l’âme d’une croyante, une âme persévérante, une âme pure ?…
Oui. Ne secoue pas la tête. Crois-tu qu’il n’y a de pur que celui qui n’a pas connu la sensualité ? Crois-tu que l’âme ne puisse plus jamais redevenir vierge et belle ? Oh, ma fille ! Mais entre ma pureté qui est tout entière grâce du Seigneur et ton héroïque ascèse pour retourner vers le sommet de ta pureté perdue, sois sûre que c’est la tienne qui est la plus grande. C’est toi qui la construis : contre la sensualité, le besoin et l’habitude. Pour moi, c’est un don naturel comme la respiration. Toi, tu dois tailler à vif dans ta pensée, tes affections, ta chair, pour ne pas te souvenir, pour ne pas désirer, pour ne pas favoriser. Moi… Est-ce qu’une petite enfant de quelques heures peut désirer la chair ? Et a-t-elle le mérite de ne pas le faire ? C’est ce qu’il en est pour moi. J’ignore ce qu’est cette tragique faim qui a fait de l’humanité une victime. Je ne connais que la très sainte faim de Dieu. Mais, toi, tu ne la connaissais pas, et c’est par toi-même que tu l’as apprise. Et l’autre faim, tragique et horrible, tu l’as domptée pour l’amour de Dieu, ton unique amour maintenant. Souris, fille de la miséricorde divine ! Mon Fils fait en toi ce qu’il t’a dit à Hébron. Il l’a déjà fait. Tu es déjà sauvée car tu as eu la volonté sincère de te sauver, parce que tu as appris la pureté, la douleur, le bien. Ton âme est revenue à la vie. Oui. Il te faut sa parole pour te dire au nom de Dieu : “ Tu es pardonnée. ” Moi, je ne peux la dire, mais je te donne mon baiser comme une promesse, comme un commencement de pardon…
O Esprit éternel, un peu de toi est toujours en ta Marie ! Permets qu’elle te répande, Esprit sanctificateur, sur la créature qui pleure et espère. Au nom de notre Fils, ô Dieu d’amour, sauve celle qui attend de Dieu son salut. Que la grâce dont l’ange m’a dit que Dieu m’a comblée se pose miraculeusement sur cette femme et la soutienne, jusqu’à ce que Jésus, le Sauveur béni, le Prêtre suprême l’absolve au nom du Père, du Fils et de l’Esprit…
168.10 Il fait nuit, ma fille. Tu es fatiguée et brisée. Viens te reposer. Tu repartiras demain… Je t’enverrai dans une famille de gens honnêtes, car il vient désormais trop de monde ici. Et je te donnerai un vêtement semblable au mien. On te prendra pour une juive. Je dois revoir mon Fils en Judée, car la Pâque approche et à la nouvelle lune d’avril, nous serons à Béthanie. Je lui parlerai alors de toi. Viens chez Simon le Zélote. Tu m’y trouveras et je te conduirai à lui. »
Aglaé pleure encore, maintenant paisiblement. Elle s’est assise par terre. Marie aussi s’est assise de nouveau. Aglaé pose la tête sur les genoux de Marie et baise sa main… Puis, elle gémit :
« On va me reconnaître…
– Oh non ! N’aie pas peur. Ton vêtement était désormais trop connu. Mais je te préparerai pour ce voyage que tu entreprends vers le Pardon. Et tu seras comme la vierge qui va à ses noces : différente et inconnue à travers la foule ignorante du rite. Viens. J’ai une petite chambre à côté de la mienne. Elle a abrité des saints et des pèlerins désireux d’aller vers Dieu. Elle t’abritera toi aussi. »
Aglaé veut reprendre son manteau et son voile.
« Laisse-les. Ce sont les habits de la pauvre Aglaé perdue. Elle n’existe plus… et d’elle il ne doit même pas rester ce vêtement. Il a reçu trop de haine… et la haine blesse autant que le péché. »
Elles sortent dans le jardin obscur et entrent dans la petite chambre de Joseph. Marie allume la lampe posée sur une petite table, caresse encore la femme repentie, ferme la porte et avec sa triple flamme s’éclaire pour voir où elle peut porter le manteau déchiré d’Aglaé pour qu’aucun visiteur ne le voie le lendemain.
Le grand théâtre de Syracuse
Aglaé, une ancienne prostituée vient trouver refuge à Nazareth et se confie à Marie. « Je suis de Syracuse (…) A Syracuse, il y a un grand théâtre. Un grand théâtre, beau, vaste… Il sert aux jeux et à la comédie. Dans les comédies et les tragédies qu’on y donne, on se sert beaucoup de mimes. Ils soulignent par leurs danses muettes la signification du chœur. Tu ne sais pas… mais les mains, les mouvements du corps peuvent exprimer les sentiments de l’homme agité par quelque passion… Dans un gymnase spécial, on enseignait à des adolescents et à des jeunes filles le métier de mime.» (EMV 168.3). La justesse et l’à propos de ce paragraphe méritent d’être soulignés.

A Syracuse il y a un grand théâtre grec de 15 000 places. C'est le plus vaste de l'île. Plus grand encore que le célèbre théâtre d'Épidaure en Grèce, il mesure 138 m de diamètre. Son plan est attribué à Democopos au 5e siècle av. J.-C. Platon, Pindare et Euripide le fréquentèrent. L'amphithéâtre romain, encore plus vaste (20 000 spectateurs), date lui du 1er au 3e siècle, et n'était donc pas connu d’Aglaé ! Les mimes étaient alors des acteurs omniprésents dans les représentations théâtrales (1).
La palestre (2) était une sorte de gymnase réservé aux adolescents. Un tel monument est fréquent dans les cités grecques. C’était un bâtiment privé, à la différence du gymnase, public, qui appartenait à la cité. L'existence d'une palestre à Syracuse paraît vraisemblable aux archéologues italiens. Sa présence dans le quartier archéologique Neapolis, au nord du théâtre grec où subsistent les traces d'un stade, est probable, mais reste à découvrir.
(1) Voir par exemple Charles Magnin, Études sur les origines du théâtre antique, Revue des Deux Mondes, période initiale, tome 13, 1838 (p. 726-731).
(2) « Palestra » dans l’original italien, « palestre » dans la traduction de 1979, « gymnase spécial» dans la traduction de 2017